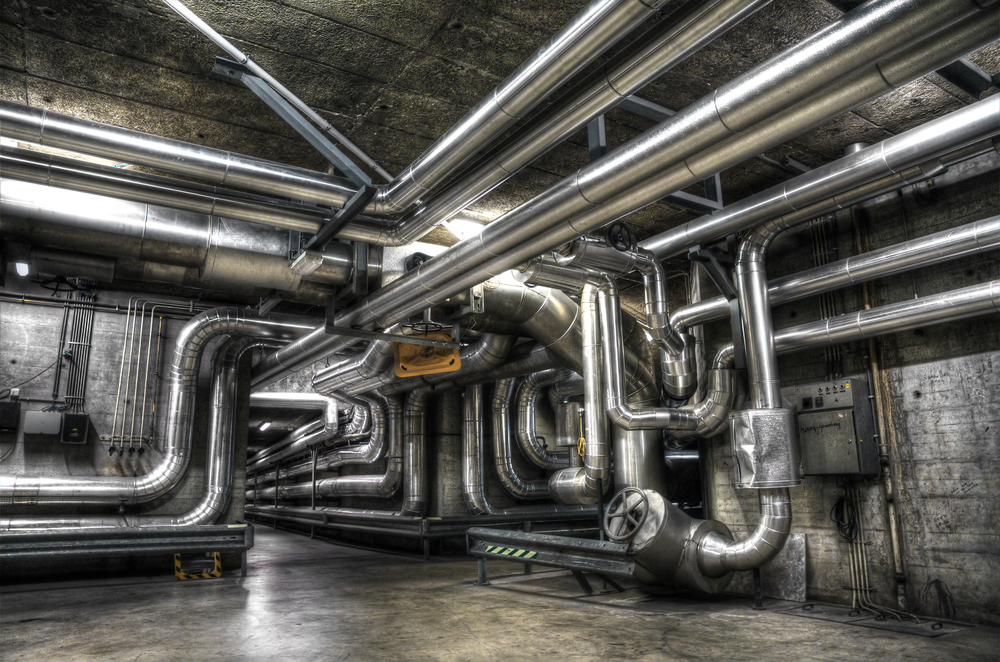2024 s’inscrit comme une année charnière pour la décarbonation de l’énergie thermique en France. Avec plus de 1 350 nouvelles installations soutenues par le Fonds Chaleur, la production de chaleur renouvelable et de récupération franchit un nouveau palier : ces installations produiront 3,6 TWh/an, marquant un progrès déterminant pour la souveraineté énergétique du pays.
Le contexte est sans appel : la chaleur représente 43 % de la consommation énergétique française et reste encore majoritairement dépendante des énergies fossiles, importées et émettrices de carbone. Malgré tout, la part de chaleur renouvelable et de récupération progresse vite : 29,6 % en 2023, avec l’objectif fixé par la loi de 38 % à l’horizon 2030. C’est dans cette dynamique qu’intervient le Fonds Chaleur, opérateur clé depuis 2009 sous la houlette de l’Ademe, qui oriente investissements publics et stratégies de planification vers des solutions locales et pérennes.
Pour 2024, les aides du Fonds Chaleur – dont l’enveloppe a été portée à 820 M€, soit +36 % par rapport à 2023 – ont soutenu près de 1 350 installations sur tout le territoire. Ces projets incarnent la montée en puissance des « Contrats Chaleur renouvelables », désormais systématisés pour accompagner aussi les petites initiatives, particulièrement dans la filière biomasse et, chose notable, avec une accélération marquée dans la géothermie et la récupération de chaleur fatale industrielle. Plus largement, lorsque l’on additionne les effets des dispositifs France 2030 et du Fonds Planification écologique, c’est près de 5,6 TWh/an de chaleur renouvelable supplémentaires qui verront le jour, soit l’équivalent de la consommation de plusieurs millions de logements français.
Le bilan du Fonds Chaleur depuis sa création est saisissant : plus de 10 000 installations accompagnées depuis 2009, près de 50 TWh/an de production thermique décarbonée, et 5,1 milliards d’euros d’aides ayant généré 16 milliards d’euros d’investissements. Sur le seul exercice 2024, les installations biomasse restent en tête (68 % de la production de chaleur financée), suivies par la géothermie (16 %), la récupération de chaleur fatale (8 %) et la méthanisation (8 %), le solaire thermique complétant le tableau. Les émissions de CO₂ évitées grâce à ces nouveaux équipements s’élèvent à plus de 805 000 tonnes par an. Ce sont autant d’économies faites sur les importations de gaz et une contribution majeure à la lutte contre le dérèglement climatique.
Du point de vue financier, l’efficience du Fonds Chaleur reste remarquable : le coût d’abattement moyen est de 51 €/tonne de CO₂ évitée, et le ratio du budget total sur la production attendue sur 20 ans s’établit à 11,40 €/MWh, un niveau compétitif comparé à d’autres dispositifs. À cela s’ajoutent des financements innovants comme le fonds de garantie géothermie ou les dispositifs de prêts bonifiés pour les logements sociaux, favorisant l’accès des collectivités et des entreprises aux solutions bas carbone.
L’impulsion donnée en 2024 bénéficie de la synergie avec les programmes France 2030 et Fonds Planification écologique : appels à projets spécifiques pour la biomasse industrielle (BCIAT, BCIB), encouragement des grands projets solaires thermiques et réseaux de chaleur, priorisation des vecteurs de chaleur en fonction des ressources locales grâce à la démarche EnR’Choix.
Quant aux perspectives pour 2025, le budget du Fonds Chaleur est maintenu à un haut niveau – 800 M€ – avec une volonté de renforcer la planification, encourager la diversification de l’approvisionnement en biomasse et accélérer encore sur la géothermie profonde et le solaire thermique. L’attention à la disponibilité de la ressource (schémas d’approvisionnement, tensions sur les plaquettes forestières) et la couverture des risques industriels participent aussi à la consolidation du modèle.
Au fil des projets soutenus en 2024, une diversité d’innovations s’illustre : solaire thermique dans la production de cognac en Charente, récupération de chaleur fatale dans l’industrie pharmaceutique à Riom, réseaux de géothermie pour l’habitat collectif en banlieue parisienne, biomasse énergie intégrée dans la filière bois savoyarde… Autant de preuves que la décarbonation de l’énergie thermique n’est plus une utopie, mais une réalité multisectorielle qui s’enracine dans tous les territoires. Ce mouvement, salué par la ministre Agnès Pannier-Runacher et le ministre Marc Ferracci, incarne un triple engagement : pouvoir d’achat, compétitivité, ambition climatique. La chaleur renouvelable et de récupération apparaît comme un pivot décisif pour répondre à l’urgence climatique, accélérer la sortie des énergies fossiles et dessiner une économie française résiliente, solidaire et pleinement souveraine.